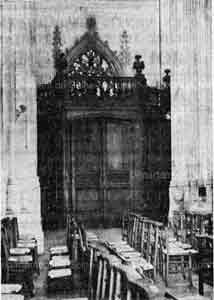|
Saint-Antoine |
 |
Les chanoines
réguliers de Saint-Antoine occupent la place d'un ancien
hôpital.
Il avait été fondé en 1323 par deux frères, Gilles et
Pierre Gaalon, sur la paroisse de Saint-Jean sur
Renelle.
Ils faisaint partie des frères de la Charité de
Notre-Dame. L'installation avait été contrariée par
l’opposition des chanoines de St-Lô et du curé de
l’église St-Jean-sur-Renelle
L'hôpital a été très rapidement donné aux Billettes qui
élevèrent une petite église sous le vocable de la
sainte-Vierge.
Accablés de dettes, les Billettes cédèrent en 1393
leur couvent aux religieux de Saint-Antoine.
La chapelle prit le titre de Saint-Thomas le Martyr. |
|
Le monastère vivait de dons et de legs. La légende rouennaise raconte
que, comme à Paris, les Antonins avaient le droit de
laisser un porc errer de par les rues, portant un
collier aux armes de l’ordre. On raconte qu’au XVIe
siècle, des désordres avaient amené le bailli à
interdire cette divagation au grand désappointement du
voisinage.
Une
partie des bâtiment fut exproprié par la ville de Rouen
en 1518 pour l'agrandissement de la place du
Neuf-Marché.
L'église visible sur le dessin de Jacques Le Lieur avait
été construite vers 1500 par le commandeur Laurent de
Blarru. Elle a été augmentée en 1728 par l'ajout d'un
collatéral, et d'un nouveau chœur. Les travaux se
terminèrent en 1745, sous la direction de l'architecte
Defrance.
A cette occasion l'église changea d'axe. Elle était
orientée, elle ne le fut plus, le nouveau chœur, à
l'ouest, ayant pris la place de l'ancien portail.
L'église possédait une chapelle
Saint-Thomas-de-Cantorbéry qui avait disparu avant le
XVIIIe siècle.
Le prieuré a été supprimé en 1780 par la Commission des
réguliers. La bibliothèque a été vendue et les locaux
transformés en magasins.
Les derniers vestiges disparurent vers 1862, lors de la
création de la rue Jeanne d'Arc. |
|
| |
| Clergé |
En 1770, le clergé se composait de 4 religieux ou
chanoines-réguliers prêtres.
En 1777, le prieur du prieuré était M. Delabatte.
En 1723, les revenus de la communauté étaient de 6 139 livres. |
| |
| Mobilier |
|
Des ossements
de saint Antoine le Grand avaient été donnés à la commanderie de
Rouen par le monastère de St-Antoine de Viennois, le 13 mai 1625.
Ils avaient été placés dans une châsse ouvragée en forme de bras (C’est
sur ce bras-reliquaire que les membres du Parlement juraient le
secret des délibérations de la Chambre du Conseil).
Au
début du XVIIIe siècle, un nouveau maître-autel
monumental avait été construit pour la nouvelle église. Il avait été
orné de tableaux représentant la vie de saint Augustin, aujourd’hui
disparus, du peintre rouennais Pierre Léger.
|
Le tambour de l'une des portes avait été transféré dans
le bras sud du transept de l'église Saint-Maclou où il
est resté jusqu'en 1939.
(Journal de Rouen) |
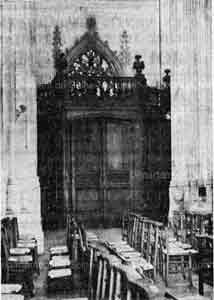 |
|
| |
| Localisation |
|

Cliquez sur l'image |
| |
|
Bibliographie |
Histoire de la ville de Rouen, F. Farin, 3e ed., 1738, t. VI,
p. 49-75.
Abrégé de l'histoire ... de la ville de Rouen, Lecoq de
Villeray, 1759, p. 391-392.
Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de
la France, J. J.
Expilly, Tome VI, 1770, p. 439.
Journal de Rouen, 31/08/1939
Rouen aux 100 clochers, F. Lemoine et J. Tanguy, 2004, p. 140-141.
Rouen à la Renaissance, L.-R; Delsalle, 2007, p.87-88. |